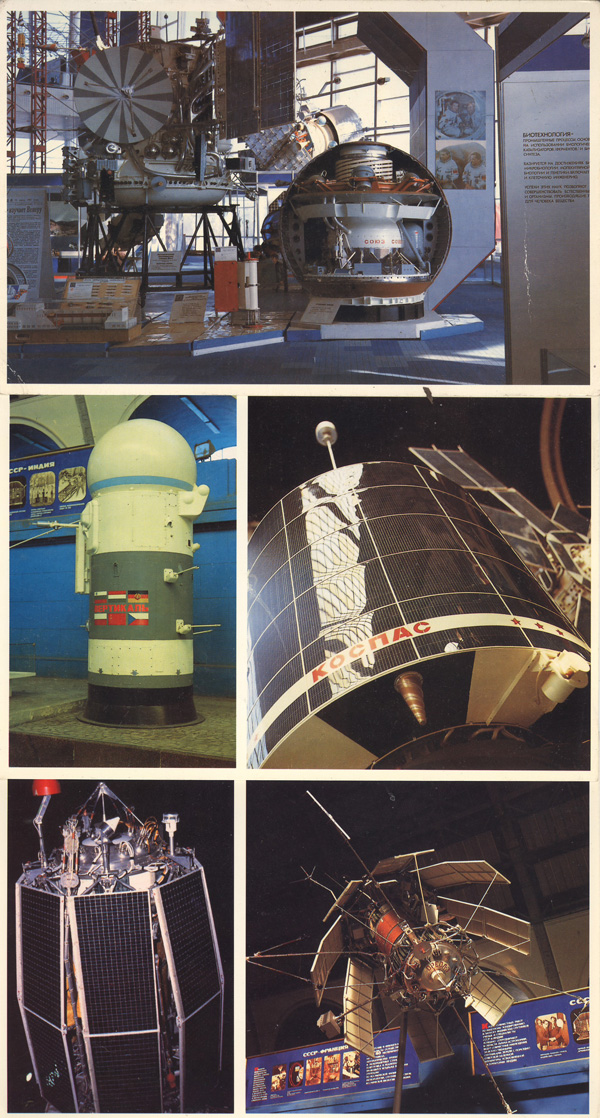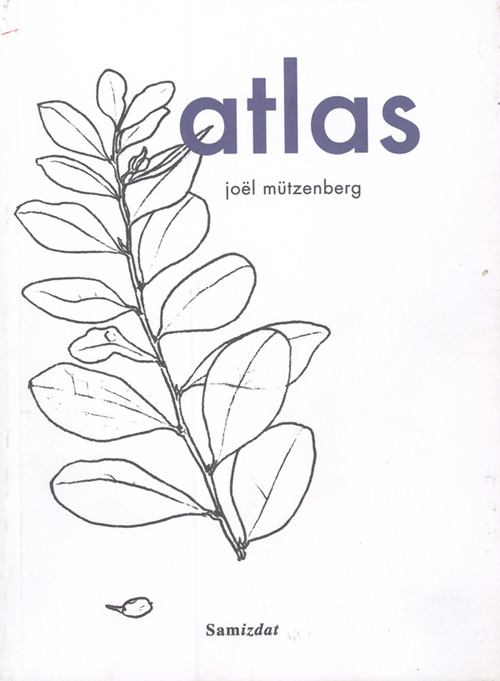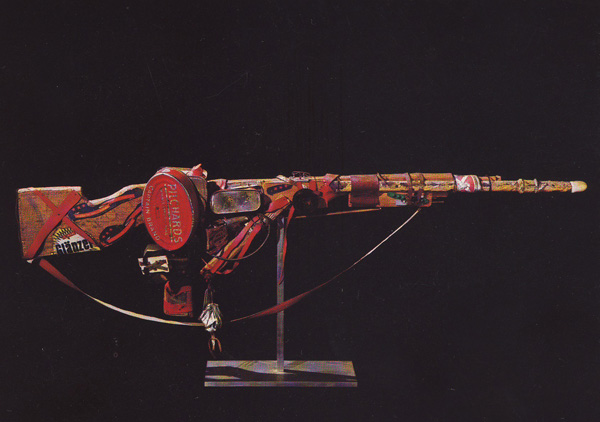Pierre loti chez lui, décontracté et mélancolique en 1893.
« Et je commence, une fois de plus, à errer sans but jusqu’à la nuit…Au crépuscule, tout à coup, je me retrouve sur l’immense place de Mehmed-Fatih, ramené par le hasard. Alors me revient cette phrase de mon journal d’autrefois, qui s’est gravée très singulièrement dans ma mémoire et s’est peu à peu liée, pour moi, à ce quartier saint, comme si elle en était l’expression même: « La mosquée du sultan Mehmed-Fatih nous voit souvent assis, Achmet et moi, devant ses grands portiques de pierres grises, étendus tout les deux au soleil, sans souci de la vie, poursuivant quelque rêve intraduisible en aucune langue humaine… »Rien n’a changé sur cette place; elle est restée un des lieux les plus turcs et les plus mélancoliques de Stamboul. La mosquée s’y dresse, indéfiniment pareille à travers les siècles, avec ses hautes portes grises, festonnées de dessins mystérieux. Et alentour, sous les treilles jaunies des petits cafés, les mêmes vieux cafetans de cachemire, les mêmes vieux turbans blancs sont assis, à cette dernière lueur d’automne. Alors, je m’arrête au milieux d’eux, à cette même place où, il y a dix ans, nous avions vu, un soir, paraître sur les marches de la mosquée un illuminé qui levait les yeux et les bras au ciel, en criant « Je vois Dieu, je vois l’Eternel! » Achmet avait secoué la tête incrédule, répondant: « Quel est l’homme, Loti, qui pourra jamais voir Allah… »
« Dans la belle nuit d’étoiles, je descends par le petit-champ-des-morts; je chemine ensuite dans Galata, qui est en pleine fête, et enfin, quittant cette rue bruyante, je m’arrête au bord de l’eau, à l’entrée d’un pont qu’on ne voit pas finir, mais qui s’en va se perdre au loin dans l’obscurité confuse. Là, tout change brusquement, comme change un décor de féerie au coup de sifflet des machinistes. Plus de foule, ni de lumières, ni de tapage: une profonde trouée de nuit et de silence est devant moi ; un bras de mer étend son vide tranquille entre ces quartiers assourdissants que je viens de traverser et une autre grande ville, d’aspect fantastique, qui apparaît au-delà sur le fond étoilé de la nuit, en silhouette toute noire dentelée de minarets et de dômes. Elle se profile si haut que les coupoles et ses mosquées, s’exagérant dans les buées enveloppantes, prennent des proportions de montagnes. »
« …Je vais tourner le dos aux quartiers neufs, aux boulevards récemment alignés, dans les parages de Sainte-Sophie et de la Sublime-Porte, qu’éclairent maintenant, hélas, des becs de gaz où circulent des voitures, des équipages d’ambassades promenant d’aventureux voyageurs. C’est vers le vieux Stamboul, encore immense que je me dirige, montant par des petites rues aussi noires et mystérieuses qu’autrefois, avec autant de chiens jaunes couchés en boule par terre qui grognent et sur lesquels les pieds butent. Mon Dieu! pourvu que quelque édile ne les détruise pas, ces chiens! J’éprouve une sorte de volupté triste, presque une ivresse, à m’enfoncer dans ce labyrinthe où personne ne me connaît plus mais où je connais tout… »